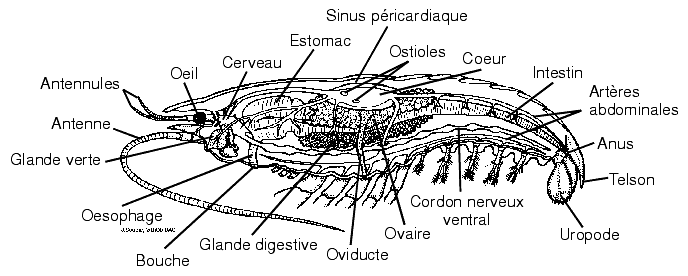AQUA +
Plonger dans le monde de l'aquaculture et bien plus encore
L'astraciculture
Généralités
Astacus : écrevisse (latin)
Astakos : homard (grec)
En France, l’écrevisse américaine a la réputation de vivre dans des milieux pollués et en eau trouble alors que pour les américains, elle est symbole d’eau pure, claire et fraiche. Les écrevisses autochtones vivent aussi dans des eaux dites « à truites ».
Comme le saumon, elle est symbole de réhabilitation d'eaux naturelles
Quand le saumon meurt, l’homme est menacé »
Ça fait seulement 40 ans qu’on commence à se préoccuper de sa disparition.
Morphologie de l'écrevisse
Morphologie interne
Morphologie externe
Eléments de biologie de l'écrevisse
Les écrevisses sont crustacées présentant des caractéristiques particulières :
- les individus vivent en groupe mais possèdent un abri individuel. Ils peuvent donc adopter un comportement individuel ou grégaire ;
- ces animaux peuvent vivre hors de l’eau ;
- en général, en début de cycle de vie, les écrevisses ont tendance à être carnivore (stade juvénile) à cause des mues puis deviennent par la suite végétariennes ;
- ce sont des espèces lucifuges(n’aime pas la lumière) et auront un mode de vie plutôt nocturne ;
- les facteurs environnementaux dont dépendent les écrevisses sont la température, le pH et l'éclairement. D'autres indices impactent les fonctions vitales de l'écrevisse tels que le métabolisme gazeux, les mouvements respiratoires et l'activité motrice ;
- les mues permettent aux écrevisses mutilées de retrouver leur appendice perdu. C'est aussi à ce moment que les animaux sont très vulnérables et que des problèmes de cannibalisme peuvent apparaitre ;
- en cas de menace, elles préfèreront la fuite.
Présentation des différentes espèces
Etude de la population
Une population est un groupe collectif d’individus d’une espèce déterminée sur un territoire bien défini. Les caractéristiques en sont :
- la densité - le taux de reproduction
- le taux de mortalité - le taux de croissance
- la structure spatiale - la distribution des âges
- les caractéristiques génétiques
L’étude dynamique d’une population d’écrevisse permet de comprendre son avenir : pourquoi certaines ont-elles disparues ? Pourquoi d’autres se sont-elles bien acclimatées ?
Etude de la structure (répartition spatiale et temporelle) but : pyramide démographique
La dynamique, avec la structure, permet de projeter la situation d’une population dans l’avenir. Ces données permettront à l’aménageur ou et l’aquaculteur de gérer les stocks sauvages ou les stocks en élevages.
En élevage, cette démarche, plus précise que dans la nature, est essentielle pour une gestion optimale avec le coût de l’alimentation et l’immobilisation de l’espace.

Cycle de vie

Menaces et prédations
Les ennemis de l’écrevisse vont du virus au pécheur. On y retrouve :
- les prédateurs (oiseaux, mammifères, poissons, certains insectes comme la larve de libellule, autres écrevisses, …)
- les pollutions mécanique lorsque des pluies orageuses vont déplacer des sédiments voir détruire des habitats, thermique, organique, chimique : Les pollutions peuvent avoir plusieurs impactent tels que la mort de l’animal, la diminution de résistance aux maladies, la baisse du taux de reproduction et/ou de la vitesse de croissance et peut modifier le génome à long terme.
Remarque : Les écrevisses sont plus sensibles aux pollutions que les poissons
- les maladies (mycoses, bactérioses, thélohaniose ou maladie de la porcelaine, parasites et virus)
Les problèmes sanitaires sont du à trois facteurs : le milieu, l’agent pathogène et l’hôte.
La peste de l'écrevisse
Aphanomyces astaci est un champignon microscopique à l’origine de l’aphanocycose ou peste de l’écrivisse qui est fatal aux écrevisses autochtones telles que l’écrevisse à pattes rouges. Aucun individu de la population n’a survécu à une « épidémie » et les spores du champignon disparait au bout de deux mois lorsqu’il ne trouve plus d’hôte. Il s’agit de la première cause de disparition des écrevisses à pieds rouges.
Lorsque les écrevisses sont atteintes de la maladie, elles ont un comportement inhabituel : elles sortent en plein jour, se promènent sur les berges et se dressent sur les pattes arrières comme sur des échasses. Lorsqu’on les soulève, les pattes pendent et le céphalothorax se décolle de l’abdomen. Puis elles tombent sur le dos, parfois elles sont secouées par un dernier spasme avant de rendre la vie.
Ce champignon est transmis par les écrevisses américaines qui sont des porteurs sains. Lorsque ces écrevisses sont saines, elles adoptent un comportement plus agressif que si elles sont infectées par Aphanomyces astaci. Existe-t-il un gène de résistance ? Certaines espèces sécrètent de la mélanine pour lutter contre ce champignon.
Les différents types d'élevages
L’écrevisse n’est pas un poisson. Elle a besoin d’un abri individuel et d’un environnement solide (gravier ou galet) et d’eau dont la température, le pH, le teneur en oxygène, en calcium, en micropolluant dépend de chaque espèce. Le choix de cette dernière s’effectue selon l’objectif de l’éleveur : repeuplement ou consommation.
Il existe trois modes d’élevages :
- extensif où l’intervention de l’homme se limite à l’introduction et la capture des écrevisses et dont les résultats sont assez aléatoires. L’éleveur choisira un étang dont la niche écologique est libre.
- intensif où tout est maitrisé : de la fécondation à la commercialisation
L’objectif est de produire un maximum d’écrevisses commerciales (taille de vente légale = 90 mm) dans le minimum d’eau, dans le délai le plus court et avec des aliments performants et peu onéreux.
- entre les deux, l’élevage semi-extensif vise à agir sur l’amélioration de l’habitat, l’aide alimentaire (mise à disposition de végétaux) et les moyens de captures.
En élevage semi-extensif, la capacité d’accueil est comprise entre 6 et 10 individus au m2. En cas de surpopulation qui se repère lorsque les tiges dures sont consommées, le risque de cannibalisme peut apparaitre. L’une des solutions est de pêcher les adultes (mâles) prêts à la commercialisation. L’autre vise à pêcher des jeunes qui serviront au repeuplement de milieux.
Attention aux aliments décomposés qui ne seront pas consommés. La densité d’un étang « productif » lors que la récolte peut atteindre 10 000 à 15 000 écrevisses/ha ce qui représente 100 à 120 kg d’écrevisses/ha/an. La récolte des écrevisses peut se faire à l’aide de nasses ou bien par la pêche « flow-trap ».
Lors de la fertilisation des étangs pour favoriser le développement de la végétation, le phosphore est à éviter car il peut entrainer le développement de Spirogyres et de Cladophores, responsables des phénomènes d’eutrophisation.
En élevage intensif, la densité dépend du nombre d’abri, du renouvellement de l’eau et de la disponibilité des végétaux. La fécondation se fait naturellement avec un mâle pour deux femelles ave 5 sujets/m2. Les œufs peuvent être laissés à la femelle qui s’en occupera entre 6 et 8 mois, jusqu’à l’éclosion. Il faudra séparer les larves juste après la première mue (avant qu’ils ne deviennent autonomes) le risque de cannibalisme maternel est présent. Les œufs peuvent être aussi prélevés dès l’apparition des yeux des petits c’est-à-dire à 21 semaines d’incubation à l’aide d’une pince, d’un couteau à pamplemousse courbe ou d’un siphon.
Les œufs sont triés à la main dans des bacs ayant un débit de 0,7 L/min à raison de 6 000 à 10 000 œufs/L : élimination des œufs non fécondés ou morts, et ceux atteints de mycoses et séparation des larves pour les placer dans un autre bassin. Le contrôle est quotidien ou biquotidien. La première mue a lieu une semaine après l’éclosion et les larves L2 autonomes sont placé dans des bacs (8 000 individus) dont le débit est entre 0,4 à 0,5 L/min entre 18 et 22 °C et avec une teneur en oxygène supérieur à 6 ppm.
L’incubation artificielle permet d’obtenir 3 à 5 fois plus de jeunes larves qu’en élevage extensif. Mais est-ce rentable sur le plan économique ? L’un des avantages permet de sauver la progéniture d’une femelle morte.
Le renouvellement est de l’ordre de 20% pour éviter les dégénérescences génétiques.
Chaque ration est adaptée selon l’âge et le nombre d’écrevisse. En termes de croissance, les jeunes consomment entre 1 à 4 % de leur propre poids par jour et entre 0,3 à 1 % pour les adultes (0,3-0,4% pour les femelles et 1 % pour les mâles en période d’accouplement).
L’alimentation doit posséder plusieurs caractéristiques :
- tenue à sec de l’aliment ;
- capacité d’immersion dans l’eau ;
- tenue dans l’eau après différentes durées d’immersions ;
- flottabilité après immersion prolongée ;
- prix abordable.
La ration conditionne les mues.
Les animaux peuvent être facilement transportables à des températures entre 6 et 8°C dans un premier temps pour ralentir le métabolisme puis entre 10 et 16°C pendant deux semaines sans être alimenté. Attention, les écrevisses ne peuvent être remise à l’eau directement car leur branchies sont habituées à un mode de vie aérien. Il faut donc procéder à une étape de « retrempage » pour ne pas les noyer.
Les maladies et le cannibalisme sont facteurs limitant pour intensifier la production.
Comparaison entre les deux types d'élevages

Le marché en France
L’élevage d’écrevisse en France est une activité complémentaire qui peut être gérée par un pisciculteur, un agriculteur ou un retraité. Il n’existe donc pas de réelle filière organisée dans le pays. La tendance est à la hausse mais négligeable par rapport aux autres productions aquacoles. Mais les principaux freins sont :
- la concurrence des crustacés marins ;
- les risques inhérents à la commercialisation de produits vivants ;
- la taille et la qualité de la chair variable ;
- l’approvisionnement irrégulier ;
- un prix de vente relativement élevé ;
Pourtant le marché est loin d’être saturé et les importations en France dépassent 1 000 tonnes/an. Les exportations ne représenteraient que 7% des importations.
Comparaison élevage écrevisses vs élevage de poissons